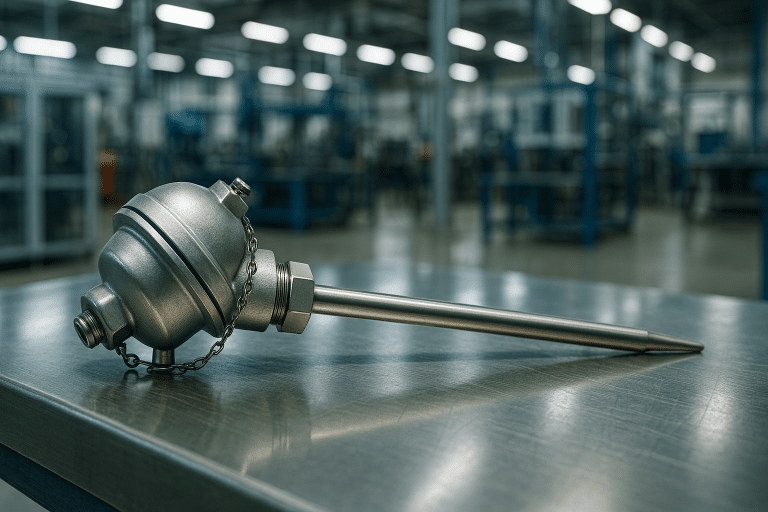Il devient difficile d’ignorer la multiplication des inondations en milieu urbain. Ces épisodes interviennent après des pluies abondantes ou des précipitations longues, transformant, le temps de quelques heures ou jours, les rues et trottoirs en véritables ruisseaux. Ce phénomène s’explique en grande partie par le développement urbain intensif :la croissance des agglomérations, avec ses nouveaux lotissements, routes et parkings bétonnés, réduit constamment la surface de sols capables d’absorber l’eau. L’eau de pluie trouve peu de zones où s’infiltrer et s’accumule alors en surface, aggravant le risque d’inondation.
À cette réalité s’ajoute l’évolution du climat. Les épisodes de précipitations intenses ont tendance à devenir plus fréquents et cette dynamique sollicite fortement les systèmes existants de collecte et d’évacuation. Dans bien des cas, ces réseaux d’assainissement, parfois conçus selon d’anciennes normes, ne suffisent plus à gérer le volume des eaux pluviales
La question suivante se pose donc : comment s’adapter pour mieux anticiper ? Plusieurs pistes de réflexion et d’action se dessinent à travers le monde et l’équipe de Greenwatt vous en fait la synthèse.
Le concept de ville-éponge : s’inspirer du vivant
L’idée d’imiter la nature dans la gestion des eaux pluviales naît en Chine au début des années 2010, face à la recrudescence des inondations dans certaines zones urbaines. Le projet de « ville-éponge », qui s’impose désormais dans le paysage de l’aménagement urbain, vise à rendre la cité plus résiliente face à l’eau.
Comment procéder ? Remplacer les sols totalement imperméables par des surfaces permettant l’infiltration de l’eau, démultiplier les espaces verts, installer des jardins de pluie, végétaliser les toits ou encore creuser des bassins de rétention. Ce panel de solutions crée des « éponges » urbaines, absorbant une part significative des précipitations pour éviter le ruissellement immédiat.
L’avantage de ces dispositifs réside dans leur polyvalence. Au lieu de miser exclusivement sur de coûteux réseaux souterrains, ils offrent une réponse plus souple à l’urgence climatique et aux sécheresses fréquentes, tout en embellissant le cadre de vie urbain. Cette approche rallie donc protection contre les inondations et amélioration qualitative des lieux publics.
Des expérimentations concrètes de villes-éponges à travers le monde
Shangai, ville-éponge initatrice
Shanghai se distingue aujourd’hui comme l’un des laboratoires majeurs de cette stratégie. Sur plus de 200 projets, la ville explore toutes les facettes du concept : sols poreux, bassins de rétention, récupération des eaux pluviales pour les usages collectifs comme l’arrosage ou le nettoyage urbain. Les premiers bilans indiquent une baisse rapide des inondations dans les quartiers concernés.
Rotterdam et ses bassins urbains
Rotterdam, en Europe, mène une réflexion toute aussi active. Dans cette ville exposée à la montée des eaux, des « bassins urbains » voient le jour sur d’anciens parkings ou dans des espaces publics réaménagés, captant puis redistribuant intelligemment la pluie tombée lors des averses. D’autres villes européennes, dont Paris et Lyon, multiplient depuis peu les toitures végétalisées, les rues drainantes et les jardins infiltrants.
Comment s’adapter en France ?
Les collectivités territoriales françaises inscrivent désormais de plus en plus ce type de gestion dans leur planification urbaine. Les nouveaux quartiers prévoient d’emblée des surfaces perméables, des réservoirs pour la pluie, et tentent d’intégrer largement la dimension végétale. Certains centres historiques, aux rues minérales, investissent dans la transformation de places publiques en parcs ou zones tampons. Chacun de ces aménagements, même modeste, contribue à bâtir une ville mieux préparée.
Les municipalités encouragent parfois les habitants à adopter des gestes allant dans le même sens : installation de parties perméables sur les trottoirs privés, récupération de l’eau de pluie, plantation d’arbres dans les cours d’immeubles ou les petits jardins, création de bandes végétalisées en bordure de voirie. L’action, progressivement, s’étend à toutes les échelles.
Les limites du « tout-technique » dans la gestion des eaux pluviales
Longtemps, la gestion des eaux pluviales reposait essentiellement sur la pose de tuyaux, de canalisations et le forage de stations de pompage massives. Mais face à la répétition des épisodes de pluie extrême, ces investissements, même importants, montrent vite leurs limites. Dans de nombreuses métropoles, les réseaux d’assainissement débordent, entraînant parfois une pollution des rivières et des milieux aquatiques.
Ce constat amène de nombreuses villes à envisager une complémentarité entre infrastructures classiques et solutions naturelles. Le recours aux villes éponges, avec sa capacité d’absorption, permet de limiter la pression sur les réseaux réduisant ainsi la fréquence des inondations et des débordements.

Que peut-on faire individuellement contre les inondations ?
À l’échelle d’un particulier, il existe différentes pratiques pour limiter le ruissellement sur son propre terrain :
– privilégier des matériaux perméables pour les terrasses, cours et allées, installer un récupérateur d’eau de pluie,
– végétaliser le toit d’un immeuble ou entretenir des bandes de gazon,
– être attentif à l’entretien régulier des zones vertes limite aussi la saturation des sols en période de fortes pluies.
Ces démarches peuvent paraître simples, mais accumulées, elles participent à la prévention des inondations tout en améliorant le micro-climat des quartiers résidentiels. Les collectivités peuvent accompagner ces efforts par des incitations et aides techniques adaptées.
Prendre en compte l’eau dès la conception des projets
A grande échelle, la prise en compte de la gestion des eaux dès le stade de la conception et de la planification urbaine évite nombre de coûteux réaménagements ultérieurs. Concevoir des zones capables d’absorber et de stocker la pluie, dès les premiers plans, protège la ville contre le risque hydrique futur et réduit l’exposition aux conséquences du réchauffement climatique.
Cette stratégie doit se retrouver dans les nouveaux quartiers écoresponsables où chaque élément – bâtiments, voirie, espaces verts – tient compte du cycle de l’eau et contribue à prévenir les épisodes extrêmes.
Miser sur les villes éponges va au-delà de la seule gestion des eaux pluviales : cette transition restaure le lien entre la cité et la nature, préservant mieux la santé publique, l’environnement et le bien-être en ville. Adopter ce modèle, c’est choisir une forme de résilience qui s’appuie sur la diversité et l’intelligence collective !
Sources :
– https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-eaux-pluviales-en-ville
– https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/09/19/en-chine-les-villes-eponges-protagent-contre-les-inondations_6189831_3244.html
Sources images : Getty images